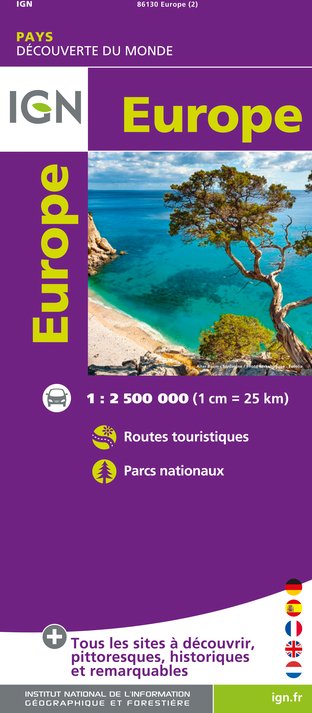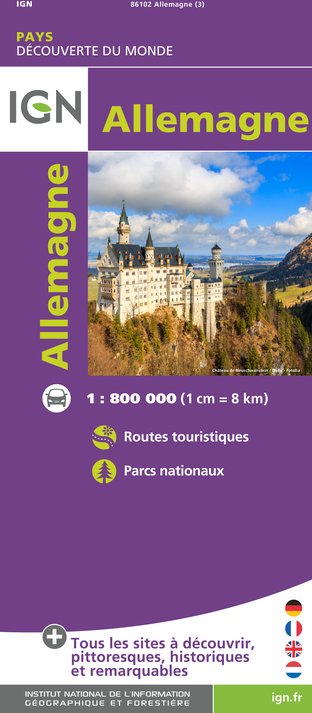Alerte
Alertes
Une maison traditionnelle
Description
D’origine très ancienne, la ville de Stavelot ne compte malheureusement presque plus de témoins architecturaux datant d’avant 1689, année où un grave incendie ravagea la capitale de la principauté abbatiale. Après le drame, bien des édifices sont reconstruits de manière traditionnelle, en pans-de-bois, bien que ceux-ci aient souvent été masqués par des enduits ajoutés à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. C’est le cas de cette bâtisse qui a connu bien des changements. Érigée au xviiie siècle, elle est « habillée » au siècle suivant avant d’être partiellement mise à nu au XXe siècle. Le rez-de-chaussée a conservé un revêtement de planches de bois tandis que l’étage a retrouvé ses pans-de-bois. Ce terme technique définit un ensemble de pièces de charpente assemblées dans un même plan et que l’on appelle indifféremment colombages. Ceux-ci peuvent prendre diverses formes : à grille, en croix de Saint-André ou en quadrillage. Ici, le quadrillage domine mais on découvre tout de même une croix de Saint-André sous la fenêtre de l’étage. Les poteaux de bois peuvent être remplis de hourdis en briques, en plâtre ou en torchis. Dressée sur un soubassement en moellons, elle est couverte d’une toiture d’ardoises. Cette belle maison, comme d’autres, est postérieure à l’incendie et constitue un témoin exceptionnel pour la compréhension de l’évolution de l’architecture en pans-de-bois au XVIIIe siècle. À Stavelot, les ossatures se simplifient, les baies s’agrandissent et la matière première est économisée : les constructions en bois s’adaptent au goût du temps et au changement de leurs fonctions.
Classement comme monument le 6 mai 1985
Informations techniques
Profil altimétrique
Cartes IGN
Auteur de la donnée